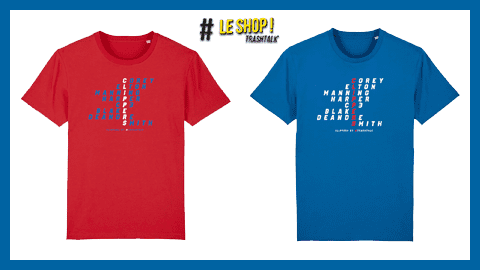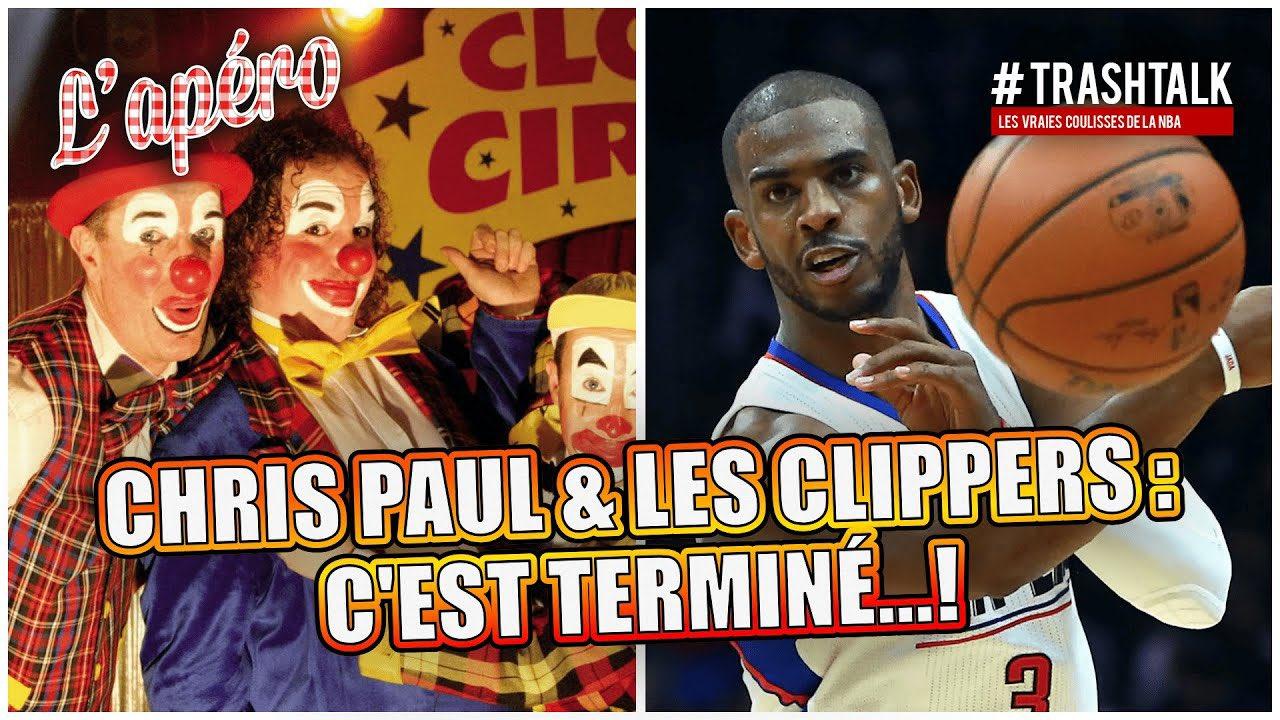Los Angeles Clippers

Le Shop Los Angeles Clippers
Les Los Angeles Clippers selon TrashTalk
Les Los Angeles Clippers. Dans l’imaginaire collectif, ils sont longtemps restés “l’autre équipe de L.A.”, celle qu’on mentionne après avoir parlé des Lakers pendant vingt minutes. Dans l’ombre du voisin starifié, les Clippers ont pourtant leur propre histoire… souvent rocambolesque. Peu de franchises NBA (National Basketball Association) ont connu autant de coups durs, de galères et de mauvaises blagues que cette équipe-là, et pourtant, elle est toujours debout. Ces dernières années, elle a même troqué son costume de loser pour celui d’outsider ambitieux, même si la malchance – et quelques blessures bien placées – se sont chargées de rappeler qu’ici, rien ne se fait sans souffrance. Mais de Buffalo à Los Angeles, en passant par San Diego, les Clippers ont toujours eu au moins une constante : une bonne dose de résilience… et un humour à toute épreuve.
Des Buffalo Braves aux San Diego Clippers
Avant de poser leurs valises en Californie, les Los Angeles Clippers sont nés à l’autre bout du pays, dans l’État de New York. En 1970, la NBA accueille une nouvelle franchise : les Buffalo Braves. Les débuts sont laborieux, avec trois saisons terminées loin des Playoffs et un plafond fixé à 22 victoires. L’ADN de lose des Clippers se met tranquillement en place. Mais qui dit défaites dit hautes positions à la Draft, et en 1972, les Braves mettent la main sur Bob McAdoo. L’intérieur devient rapidement la première grande star de la franchise : rookie de l’année 1973, MVP en 1975, trois fois meilleur scoreur de la Ligue (de 1974 à 1976), et moteur des trois qualifications consécutives en Playoffs (1974, 1975, 1976). Les Braves n’iront pas plus loin que les demi-finales de Conférence, mais pour une jeune équipe, c’est déjà un exploit.
En 1976, Bob McAdoo est envoyé aux New York Knicks et la lumière s’éteint brutalement pour les Buffalo Braves. Les Playoffs disparaissent du radar (15 saisons sans y participer), et un événement pour le moins unique change le destin de la franchise. En 1978, Irv Levin, propriétaire des Boston Celtics mais californien de naissance, rêve de déplacer “son” équipe sur la côte Ouest. La NBA refuse de sacrifier un monument comme Boston, et propose un échange de franchises : Levin récupère les Braves, qu’il déménage à San Diego, tandis que John Y. Brown – patron des Braves – prend le contrôle des Celtics. Nouvelle ville, nouveau nom : les Clippers, en hommage aux clippers, ces voiliers rapides qui naviguaient autrefois le long de la côte californienne.
À San Diego, les Clippers espèrent un nouveau départ, mais l’histoire ne prend pas vraiment la bonne direction. Malgré quelques joueurs talentueux, les bilans restent médiocres, et la franchise peine à trouver une identité sportive. En 1981, elle est rachetée par Donald Sterling, magnat de l’immobilier de Los Angeles, qui finira par la rapatrier dans sa ville natale trois ans plus tard. Le voyage vers la Cité des Anges est lancé… mais les résultats, eux, vont rester au point mort encore longtemps. Seule réjouissance à cette époque, en ayant dans leurs rangs World B. Free, les Clippers disposent d’un bon joueur avec le blaze le plus cool de l’histoire de la NBA.
Déménagement à Los Angeles et années galère
En 1984, Donald Sterling concrétise son projet : les Clippers quittent San Diego pour s’installer à Los Angeles. Sur le papier, le marché est plus grand, les perspectives financières plus solides… mais sur le parquet, rien ne change. Pendant des années, les Clippers restent abonnées aux bas-fonds du classement, enchaînant saisons négatives et éliminations précoces – quand ils parviennent à voir les Playoffs (comme en 1992 et en 1993), ce qui est rare. À L.A., les projecteurs sont braqués sur les Lakers de Magic Johnson, et les Clippers peinent à exister autrement qu’en punching-ball local.
Le premier rayon de soleil arrive à la fin des années 80 avec la Draft de Danny Manning, premier choix en 1988. Talentueux ailier capable de tout faire, il mène les Clippers à un rare bilan positif en 1992 (45-37) et à leur première apparition en Playoffs depuis 1976. L’équipe récidive en 1993, mais à chaque fois, l’aventure s’arrête dès le premier tour. Les saisons suivantes replongent rapidement dans la médiocrité : blessures, choix de Draft douteux, effectifs mal construits… le cercle vicieux est bien installé.
La fin des années 90 voit l’émergence d’Elton Brand, récupéré en 2001 après deux saisons à Chicago, et véritable machine à double-double. Mais là encore, le talent est trop isolé : autour de lui, on aligne Chris Kaman, Corey Maggette, Cuttino Mobley ou encore Quentin Richardson, de bons joueurs, mais pas de quoi changer radicalement la trajectoire d’une franchise qui peine à se faire respecter. Pendant près de deux décennies, les Clippers se bâtissent une réputation peu enviable : celle d’être l’équipe la plus malchanceuse – ou la moins compétente – de la NBA.
Lob City et l’ère Chris Paul / Blake Griffin
Pour enfin quitter le rôle de faire-valoir, les Clippers misent sur la Draft et un peu de culot. En 2009, ils obtiennent le premier choix et sélectionnent Blake Griffin, intérieur explosif promis à un avenir de superstar. Blessé pour toute sa première saison, il débute finalement en 2010-11 et électrise instantanément la NBA avec ses dunks surpuissants. Un autre jeune intérieur, DeAndre Jordan, complète la raquette, mais il manque un chef d’orchestre. En décembre 2011, la donne change : Eric Gordon, alors considéré comme l’un des meilleurs jeunes arrières de la Ligue, est envoyé à New Orleans dans un échange XXL qui ramène Chris Paul. Meneur d’élite, CP3 apporte vision de jeu, leadership et sang-froid, transformant les Clippers en une machine à highlights.
Avec Chris Paul à la mène, Blake Griffin et DeAndre Jordan dans les airs, et un supporting cast solide (Jamal Crawford, Matt Barnes, J.J. Redick), la franchise entre dans une nouvelle ère : celle de “Lob City”. Les Clippers deviennent une attraction majeure, enchaînant les actions spectaculaires et enfin, les victoires. Sous les ordres de Doc Rivers à partir de 2013, ils s’installent régulièrement dans le haut du classement à l’Ouest.
Mais derrière le spectacle, les limites apparaissent vite. Malgré plusieurs saisons à plus de 50 victoires et des ambitions légitimes, les Clippers ne dépassent jamais les demi-finales de Conférence. Blessures, effondrements improbables en Playoffs – comme en 2015 face aux Rockets après avoir mené 3-1 – et tensions internes empêchent l’équipe de franchir un vrai cap. En coulisses, un autre séisme frappe la franchise : en 2014, Donald Sterling est banni à vie de la NBA après la publication d’enregistrements à caractère raciste. La ligue force la vente, et Steve Ballmer, ex-PDG de Microsoft, rachète les Clippers pour 2 milliards de dollars, ouvrant un nouveau chapitre.
Une meute de chiens affamés (2018–2019)
Après la fin de Lob City et les départs successifs de Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan, beaucoup s’attendent à voir les Clippers plonger dans les profondeurs du classement. Mais la saison 2018-19 déjoue tous les pronostics. Portés par un groupe sans superstar mais plein de mordant — Lou Williams en sixième homme létal, Patrick Beverley en pitbull de service, Montrezl Harrell en dynamiteur de raquette et le rookie Shai Gilgeous-Alexander à la mène — les Clippers arrachent 48 victoires et un billet pour les Playoffs dans une Conférence Ouest impitoyable.
Au premier tour, ils défient les Warriors version “Death Lineup” avec Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Et même si la logique finit par l’emporter (4-2 Golden State), les Clippers signent l’un des plus gros coups de l’histoire des Playoffs : un comeback de 31 points lors du Game 2 à l’Oracle Arena. Ce run, marqué par l’énergie, l’intensité et l’absence totale de complexe, devient un jalon fondateur pour la suite : les Clippers prouvent qu’ils peuvent exister sans star, tout en se rendant attractifs pour… les futures stars.
L’ère Kawhi Leonard et Paul George
L’été 2019, galvanisés par la saison héroïque de la “meute de chiens”, les Clippers frappent un grand coup sur le marché : Kawhi Leonard, tout juste sacré champion avec Toronto, choisit Los Angeles… mais pas les Lakers. Dans la foulée, Paul George est récupéré via un échange XXL avec Oklahoma City, au prix d’un paquet de tours de Draft et du prometteur Shai Gilgeous-Alexander. Steve Ballmer et Lawrence Frank viennent de poser les bases d’une équipe censée viser le titre dès la première année.
Sur le papier, l’effectif est armé : Leonard et George encadrés par Patrick Beverley, Lou Williams, Montrezl Harrell, Marcus Morris et Ivica Zubac, le tout sous la direction de Doc Rivers. Mais la saison 2019-20 est marquée par des blessures à répétition et une gestion controversée du “load management”. Dans la bulle d’Orlando, les Clippers s’écroulent en demi-finale de Conférence contre Denver après avoir mené 3-1, un naufrage qui laisse des traces.
Tyronn Lue remplace Rivers à l’été 2020 et parvient, dès sa première saison, à emmener les Clippers en finale de Conférence pour la première fois de leur histoire. Un exploit réalisé malgré la blessure de Kawhi Leonard face au Jazz au deuxième tour, et grâce à un Paul George en mode leader offensif. Mais la marche suivante reste non franchie : les Suns d’un Chris Paul revanchard stoppent la route vers les Finales NBA.
Depuis, le scénario se répète : effectif prometteur, ambitions élevées, mais espoirs minés par les pépins physiques de ses deux superstars. Même avec l’ajout de joueurs solides comme Norman Powell, Robert Covington ou Russell Westbrook, les Clippers n’ont pas réussi à capitaliser sur leur fenêtre de tir. Et avec Kawhi et George approchant de la trentaine avancée, la question devient pressante : cette ère peut-elle encore offrir le titre tant attendu ou risque-t-elle de rejoindre la longue liste des occasions manquées de la franchise ?
L’Intuit Dome, nouvelle maison des Los Angeles Clippers
À l’été 2024, les Clippers quittent enfin la Crypto.com Arena (ex-Staples Center) pour inaugurer leur propre antre, l’Intuit Dome, symbole de leur volonté d’exister en dehors de l’ombre des Lakers. Mais la saison 2024-25 tourne court : George est échangé aux Sixers, James Harden fait le chemin inverse. Kawhi Leonard se blesse gravement et ne joue que 37 matchs, une sale habitude pour l’ailier. Malgré un effectif profond (Norman Powell, Bodgan Bogdanović, Kris Dunn, Nicolas Batum…) et les énormes progrès du pivot Ivica Zubac, l’équipe sort dès le premier tour des Playoffs. Steve Ballmer maintient sa confiance en Tyronn Lue, mais un parfum d’incertitude flotte sur la suite du projet.
Dernière mise à jour le 12/08/2025